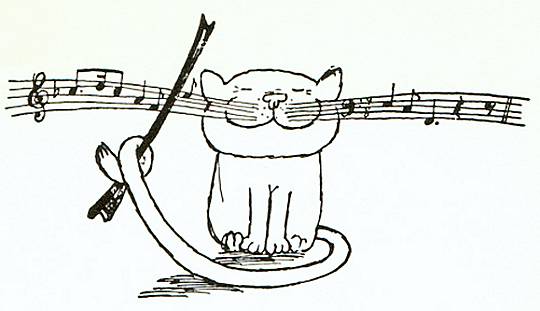
Dessin de Gerard Hoffnung.
La musique pour moi, tout au long de ces années 70, ne se limite plus aux cordes frottées. Je l'explore en tous sens. Je m'y perds, elle me dévore. Car l'amour de la musique s'aggrave de l'amour tout court.
En août 69, mon copain Dominique Michelet m'invite à Rocamadour, où la chorale de son oncle Bernard tient son camp d'été. C'est là que je rencontre Z. Coup de foudre. Je l'épouserai deux ans plus tard.
Z. adore chanter, elle a une jolie voix et de qui tenir. Ses parents ont étudié la musique, ils auraient fait carrière si la guerre n'avait brisé leur élan, jointe à un manque total d'ambition. La mère est une pianiste admirable. Le père a une voix splendide, vous arracherait des larmes en chantant «Phidylé» de Duparc, joue très bien du violon, se débrouille au piano sans jamais avoir appris, passe des heures à improviser, voix et clavier, planant sur son nuage. Tous deux vivent à l'écart du monde, en dehors du temps. Leurs études à la Schola cantorum, très classiques, leur ont laissé une vénération pour Vincent d'Indy et plus que de la méfiance vis-à-vis des musiques plus récentes. J'évite, pour ne pas les blesser, certains noms dangereux comme Xenakis, Boulez, Webern ou même Bartok. Parlons plutôt de Canteloube ou Déodat de Séverac — je les aime aussi. Je jouerai avec mes beaux-parents des quatuors de Mozart, Chausson et Fauré avec piano (sans violoncelle, hélas), mais pas souvent : ils habitent loin, et jouant avec eux je me sens plus que jamais nu et nul.
Mais place au chant choral, le bienfaisant chant choral qui permet de se perdre dans la masse. L'amour de Z. et de la musique font de moi un choriste assidu dès notre retour à Paris, en septembre 69. La chorale Saint-Thomas d'Aquin est de celles qui accueillent tout le monde sans sélection, et elle se ressent aussi de ses origines paroissiales ; mais à côté du noyau mou des nunuches de bonne famille, le groupe recrute aussi ailleurs et se distingue par une belle richesse humaine. Le chef est l'un des fils du ministre Edmond Michelet — ce que le gaullisme a fait de mieux. Tous les membres de la tribu, qui viennent nombreux nous renforcer, ont hérité de la même générosité, de la même gentillesse, qui vous feraient presque aimer le catholicisme. Les répétitions se traînent un peu, c'est vrai, les concerts n'atteignent pas les sommets, on se chagrine un peu parfois de l'austérité des goûts du chef, de ce Magnificat de Lechner pas très bandant, de cette messe Æterna Christi munera de Palestrina plutôt frigide et qui semble, en effet, durer éternellement, au lieu d'autres œuvres dont je vais chercher les noms dans les livres, ces Prophéties des sibylles de Roland de Lassus, étonnantes paraît-il, qui me font rêver, ou le Cantique des cantiques de Palestrina, la seule œuvre un peu sexy du maître, dit-on, son chef-d'œuvre, dont je vais chercher la partition jusqu'aux Pays-Bas ; mais les chansons de la Renaissance, Janequin, Sermisy, Certon, Goudimel, ont bien du charme, et puis les week-ends de chorale ou les camps d'été sont des moments attendus de tous, chaleureux et joyeux, à l'image d'un chef que tout le monde adore.
Bernard Michelet lui-même chante chez Stéphane Caillat, dont la chorale est alors l'une des meilleures de France. Les deux groupes jouent les vases communicants : certains choristes de chez Caillat viennent parfois nous donner un coup de main, et les plus dégourdis d'entre nous passent un jour à l'étage supérieur. Ce qui m'arrive au bout de trois ans, Z. me suivant presque aussitôt.
On est tout fier, tout timide. On se sent petit dans la cour des grands. On hésite à tutoyer le chef, comme c'est la règle. Stéphane Caillat, il est vrai, a de quoi impressionner. Parfait musicien, fin pédagogue, profondément cultivé, ouvert à toutes les musiques, il est à quarante-cinq ans au sommet de son art. À cela s'ajoutent les qualités qui font les bons chefs, sa présence physique, sa belle voix grave, son rayonnement, son sens de l'humour, ses calembours dont je suis jaloux.
Sa chorale accueille une cinquantaine de chanteurs de provenances et d'âges divers, pour la plupart entre vingt-cinq et cinquante ans. Contrairement aux chorales de base, qui servent souvent de refuge aux âmes esseulées, les motivations sont ici musicales avant tout. Certains parmi nous sont de futurs pros, ou d'excellents amateurs. Quelques rares emmerdeurs et -euses mis à part, tout le monde est ouvert et souriant. La musique adoucit-elle, ou sont-ce les doux qui vont vers elle ? Ce grand blond d'allure un peu lunaire, si calme, qui se déplace à vélo, c'est un moine. L'abbaye de la Pierre-qui-Vire l'a envoyé se perfectionner en musique à Paris. Après son départ, la chorale va lui rendre visite là-bas, en Bourgogne : c'est lui, le frère Hubert, qui est chargé de la vie musicale de l'abbaye. Remarquable flûtiste, il enregistrera des disques plus tard.
Le niveau musical chez Stéphane est naturellement plus élevé que chez Bernard, le travail plus exigeant, plus rapide. On fait venir chaque semaine, pour ceux qui le souhaitent, un professeur de chant, Mme Christol. Chacun découvre avec elle, première leçon, les secrets de la respiration ventrale : elle pose d'abord notre main sur son abdomen, dont les rondeurs sont violemment comprimées par un corset, sous l'œil des camarades qui se marrent en douce, et fait marcher la soufflerie ; ensuite, en quelques exercices, elle fait sortir la voix de chacun, la vraie voix cachée, comme un lapin d'un gibus. C'est ainsi que grâce à Totol — nous l'appelons ainsi entre nous —, le ténor léger que je croyais être se retrouve doté, miracle dont je m'étonne encore, d'un organe de basse profonde qui me restera toujours vaguement étranger.
Le répertoire du chœur est d'une qualité, d'une variété exemplaire, de Guillaume de Machaut à Betsy Jolas en passant par Monteverdi, Bach, Mozart, Massenet, Brahms, Honegger, Stravinsky... Un rêve. Arrivé un an plus tôt, j'aurais enregistré le disque Xenakis. En cinq ans nous allons chanter un peu partout en France, mais aussi en Suisse et en Belgique, avec, presque toujours, à la fin des concerts, un sentiment de plénitude collective, de belle ouvrage, de mission accomplie.
Deux souvenirs se détachent : les deux fois où nous chantons Noces, de Stravinsky, pour quatre solistes, chœur, quatre pianos et percussions : c'est un rituel primitif, comme le Sacre ; un déchaînement rythmique impérieux, implacable, comme le Sacre ; une œuvre moins connue que le Sacre, étant matériellement difficile à monter, mais non moins géniale. Nous la donnons d'abord à la salle Gaveau en 1973, et ce que mon professeur de musique, M. Loupias, m'annonçait jadis, que chanter en chœur c'était devenir musique soi-même, ne sera jamais pour moi aussi vrai que ce soir-là. On oublie son petit moi, on n'est plus qu'une partie d'un corps géant ; ce n'est pas encore la transe vaudoue, mais pas loin.
Les secondes Noces ont lieu à Vaison-la-Romaine en 1974. Les Choralies, organisées tous les trois ans, sont le grand rassemblement du mouvement choral À cœur joie. Un mouvement de masse utile sans doute, mais alourdi en ce temps-là par le conservatisme de ses fondateurs. Nous sommes des milliers de choristes, qui nous retrouvons tous les soirs au théâtre antique pour le grand concert. La soirée préparée par Stéphane Caillat et Guy Reibel, la seule à s'ouvrir aux musiques d'ailleurs et d'aujourd'hui, se fait siffler par une partie du public, pourtant physiquement jeune. La fin du concert, c'est Noces, que nous chantons devant cinq mille personnes, avec rage, comme s'il fallait encore se battre pour cette musique vieille de soixante ans déjà, mais d'une si brûlante verdeur que ce soir-là elle coupe leur sifflet aux siffleurs. Les protestations, s'il y en a, sont noyées dans l'ovation géante, digne d'un match de foot. Il est bon d'avoir vécu ça une fois au moins dans sa vie.
En dehors des concerts, la chorale nous offre des à-côtés moins attendus. Quelques volontaires parmi nous tournent un jour, aux studios de Boulogne, une pub chantée pour les chaussures André. Des jolies chaussures comm'çaaa, c'est André (bis), le degré zéro du texte, la musique idem, mais c'est payé, et au lycée quelques jours plus tard, un élève m'ayant reconnu à la télé, ma popularité monte en flèche.
Expérience plus étrange : Peter Brook tournant un film sur Gurdjieff, Rencontre avec des hommes remarquables, une douzaine d'entre nous se retrouvent au quartier général de la secte fondée par ledit Gurdjieff, non loin de la porte Maillot, pour enregistrer la bande son. Sous la direction du compositeur, Alain Kremski, nous psalmodions de longues mélopées planantes sans autres paroles que des mmmmm et des aaaaa. On nous offre le thé ; il y a là, prostré sur une chaise, un gros homme au teint rose, l'air anéanti par le surmenage ou la déprime : Peter Brook lui-même. Lui et Kremski sont membres de la secte. Je verrai le film plus tard, mais ne m'entendrai pas : l'un de nous avait une voix si vilaine qu'il a fallu réenregistrer avec d'autres.
Toute cette chanterie prend un temps fou : Z. et moi, pendant les deux ans où nous appartenons aux deux chorales avant de lâcher Bernard, répétons quatre soirs par semaine.
Pourtant ce n'est pas tout.
Les instruments et la voix, que je pratique séparément, je rêve de les réunir. Les années 70 sont justement l'époque, chance inouïe, où l'on redécouvre la musique du Moyen-Âge ou de la Renaissance, fraîche, vivante, plutôt simple, accessible à des amateurs — d'autant que le niveau des exécutions, dans ces temps héroïques, reste assez primitif. Jamais je n'oserais jouer en public un quatuor classique, on me jetterait des tomates ; mais une estampie du XIVe siècle ? Une chanson du XVIe, voix et instruments mélangés, comme on faisait alors ? Essayons.
Je me mets à la flûte à bec, un jeu d'enfant après le violon. Je travaille tous les jours ; bientôt j'arrive à jouer des petites pièces baroques, des sonates de Haendel. Lors d'un mini-concert de la chorale Michelet, pendant notre camp d'été, dans un vague centre de vacances, Bernard me laisse jouer deux ou trois danses de la Renaissance. Mes débuts publics ! Je n'avais pas prévu le trac. Extrait soudain du groupe, envahi par la panique, je manque avaler ma flûte à la première note, puis mes doigts tremblent horriblement, et plus je merdoie plus je tremble. Un désastre. Cette pièce de trente secondes sera le morceau le plus long de ma courte carrière.
Après cette démonstration, comment convaincre Bernard d'accueillir les instruments parmi les voix ? De toute façon il n'était pas chaud. Il ne me reste plus qu'à créer mon propre ensemble. Je recrute deux instrumentistes : un jeune normalien matheux, bon violoniste, futur compositeur, Robert Pascal, et un professeur de russe que j'ai connu au service militaire, expert ès flûtes à bec baroques, Bernard Kreise. Robert et moi découvrons la vièle à archet, ancêtre du violon, et mes flûtes ne me suffisant pas, je commande à un luthier allemand un cromorne, sorte de hautbois préhistorique à la voix de canard fâché. Avec nous, trois chanteurs : Michel Montant, qui nous suit de chorale en chorale, Laurence rencontrée chez Stéphane, et Z. bien sûr. Nous allons répéter ensemble trois ou quatre ans pour donner des concerts minuscules dans des écoles, des maisons de la culture lointaines, des églises de village et même, une fois, chez des gens de la haute, avec un petit cacheton à la clé.
Le nom du groupe : les Gays Bransleurs. Ne voyons pas là Sodome et Gomorrhe, mais un hommage à une danse ancienne, le branle gai, et surtout un sain refus de se prendre au sérieux, conscients que nous sommes de notre amateurisme. Ce nom restera secret, caché sous les initiales G.B.
Un été, les G.B. passent ensemble une semaine à travailler en Provence, dans la maison de mes parents. Deux ou trois ans plus tôt, ailleurs en Provence, nous étions cinq (nos amis allemands Maja et Hermann sur leurs violes, Robert, le cousin Marc et moi sur nos machins modernes), pour jouer de sublimes pièces pour violes de Purcell et autres Anglois.
Mais s'adonner à la musique aussi goulûment ne suffit guère. De même qu'un écrivain doit lire, un musicien, pour s'aiguiser l'oreille, doit écouter les autres, les meilleurs surtout, les moins bons aussi, un peu. J'achète des disques. Je cherche à connaître les musiques de toutes sortes et de toutes époques. Pas tellement le temps d'aller au concert, quelques grands moments tout de même : aux Choralies de 1971, un invité surprise, Sviatoslav Richter, met le feu aux Études symphoniques de Schumann ; aux Choralies toujours, trois ans plus tard, dans une salle de patronage, un gamin de treize ans joue Debussy et Messiaen avec une autorité fantastique, ce jeune Pierre-Laurent Aimard ira loin.
N'oublions pas surtout la musique de notre temps. Z. et moi sommes abonnés pendant toutes ces années aux soirées du Domaine musical, dirigé après Boulez par Gilbert Amy. Varèse, Stockhausen, Xenakis, Boucourechliev, Nono, Globokar... Ces concerts-là ne sont pas de délicieux bains relaxants, mais des douches écossaises, des voyages exploratoires, des épreuves sportives, où l'on prend de tout en pleine poire, où l'on s'ennuie rarement, où c'est drôle parfois, surprenant souvent, stimulant toujours.
L'opéra enfin. Berg à nouveau : un Lulu de rêve, dirigé par Boulez, mis en scène par Chéreau. Boris Godounov et la Khovantchina de Moussorgski par des Russes. Wagner que je découvre alors, son Parsifal que j'écoute à l'Opéra une fois et chez moi des dizaines de fois, partition sous les yeux, adoration, exaltation, fleuve infini, Wagner coulant dans mon sang.
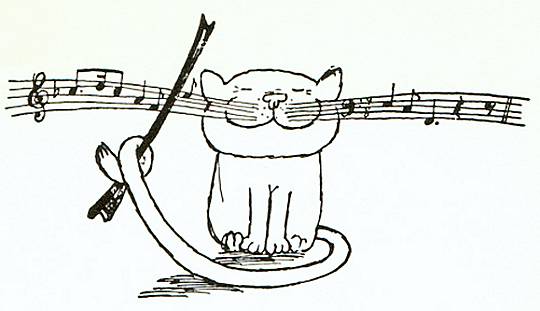 Dessin de Gerard Hoffnung. |