


MALOU EN MAI
Suite et fin de notre feuilleton
RENCONTRES AVEC LES DIEUX
 |
 |
 |
L'an prochain, Jane Birkin chantera : 69, année érotique... Pour l'instant, pas question de rigoler. Nous sommes aux premiers jours de mai 1968, année consacrée au sport, avec Jeux olympiques à Mexico dans quelques mois. On vient d'ouvrir à Font-Romeu (Pyrénées-Orientales), 1800 mètres, air pur et soleil garantis, un centre d'entraînement où montent nos meilleurs athlètes. Et nous aussi, Jacques, Roland et moi. Pas chez les champions, mais plus bas, dans le village, à l'hôtel. Nous n'en sommes pas moins des sportifs, et nos Jeux à nous sont proches. Concours, J-10. Font-Romeu, c'est le sommet de la préparation, l'arme secrète, le petit plus qui nous donnera le punch décisif : une semaine d'oxygénation intensive, juste avant l'écrit.
Nous sommes montés là-haut avec des tonnes de bouquins et de notes, que nous lisons et relisons, seuls ou par deux ou tous les trois, du matin au soir. La routine. Trois ans que ça dure. La seule détente : une promenade le soir après dîner. Parfois, dans l'après-midi, je monte en petites foulées entre les sapins jusqu'au centre olympique. L'air est si frais, si pur, qu'il met les poumons à vif. Je voudrais apercevoir mon ancien prof de gym, Jean-Paul Anton, sélectionné en boxe, ou mieux encore, les nageuses dont on dit qu'elles viennent d'arriver. Je ne vois rien. Tout se passe dedans à l'abri des regards, comme dans les centrales nucléaires.
Dans les rues du village nous guettons les naïades. Elles ont notre âge, vingt ans, ou un peu moins. Kiki Caron, la star du groupe, a sa photo dans toutes les gazettes. Blonde comme une poupée Barbie, grande et carrée comme un rugbyman, on devrait la repérer de loin. Mais Font-Romeu reste désert. Forcément, dit Roland, vous croyez que les entraîneurs vont les laisser descendre seules, sachant que Jacques est là ?
Jacques est le roi des tombeurs. Il vole de fille en fille. Un soir, à l'internat, il a soudain déclaré qu'il allait de ce pas draguer l'infirmière, une jolie vieille de trente ans ; il est revenu un quart d'heure plus tard, impassible, a murmuré : Porte close, et s'est replongé dans son thème grec. Son premier échec, sans doute. Mais ce qu'il y a perdu en prestige, il l'avait regagné d'avance, et au delà, par cette audace inouïe. Avant Font-Romeu, à Collioure, nous avons rencontré l'une de ses ex, plus âgée que lui, grande, fine, qui apparemment y reviendrait volontiers, s'il voulait.
Une ou deux fois, Jacques s'éclipse pour faire une course et nous annonce au retour qu'il les a vues. À la pharmacie (Ah ah! elles se dopent ! Tu as vu ce qu'elles prennent ?). Ou dans une pâtisserie (Tu les as laissées se goinfrer, salaud ? Et si elles coulent comme du plomb à Mexico ?). Le groupe entier ou Kiki toute seule (Vous vous revoyez quand ?). Lui, sourire impénétrable. Il est capable de tout.
Entre-temps, à Paris, ça commence à chauffer. Le soir au dîner, devant la télévision, nous découvrons les premières grandes manifs. Les commentateurs sont pris de court. Invitée privilégiée de l'unique chaîne, la longue figure de M. Peyrefide, ministre à l'époque (de l'Education ? de l'Intérieur ?), s'allonge de jour en jour. Pourquoi cette violence ? C'est la faute à la pègre, déclare le personnage. Ces manifestants ne sont pas des étudiants, mais des voyous venus flanquer la pagaille.
Nous ricanons. Monsieur le ministre joue au con, à moins qu'il ne le soit. Notre trio n'est guère politisé, mais nous n'avons pu ne pas sentir, autour de nous, la pression monter peu à peu.
Ça chauffe au Quartier Latin. En notre absence on dresse des barricades, on brûle des voitures à deux pas de la rue d'Ulm. Nous rentrons à Paris un matin par le dernier train avant la grève ; tout le réseau sera paralysé le même soir. Au lycée ce jour-là, veille de l'écrit, des bruits circulent : il se peut que l'épreuve soit reportée. Nous avons déjà connu, en 67, les affres du trac avant l'écrit ; cette fois le supplice, plus raffiné, consiste en un fondu enchaîné continuel entre l'angoisse de passer le concours et celle de ne pas le passer.
Le lendemain matin au dernier moment, confirmation : nous n'irons pas composer aujourd'hui. Ni demain ni les jours qui viennent, du train où vont les choses. Nous croisons rue Soufflot notre camarade Laurent Surgères, aussi dégagé que nous politiquement, dont j'admire l'élégance, le quant-à-soi, l'ironie discrète ; il nous quitte aussi sec, tout excité, pour aller rue d'Ulm renforcer les troupes militantes qui occupent l'École. Laurent Surgères ! Où allons-nous?
Le concours n'aura lieu qu'à l'automne ; ce sera officiel dans quelques jours, mais déjà tout le monde s'en doute. Nous voilà aussi désorientés qu'un âne délesté de son bât ; qu'un sportif qui s'est entraîné un an comme un dingue, un amoureux qui attend depuis des mois le moment de séduire la femme qu'il aime, et à l'heure dite, crac, on arrête, allez vous rhabiller. Voilà ce que sera pour moi, avant tout, mai 68 : un gigantesque coïtus interruptus.
Je vais maintenant rester une dizaine de jours au cœur du Quartier Latin, en plein dans la tourmente, il va se passer tout près de moi des choses qui resteront dans les livres d'histoire ; et moi, je ne verrai rien — ou du moins, trente ans plus tard, je ne me souviendrai de rien. Mais où étais-je, et qu'ai-je donc fait ? Un tel oubli est trop profond pour ne pas avoir un sens, lequel m'échappe. Evidemment je pourrais consulter les documents, qui ne manquent pas, je crois ; mais j'avoue qu'ils m'emmerdent, l'histoire n'est pas mon fort ; ce qui m'intéresse au moment d'écrire, c'est justement les défaillances de ma mémoire, les trous, les altérations, tout ce travail caché qui au lieu de me livrer mon passé tel quel, le fait bouger, mûrir comme un être vivant.
J'ai des souvenirs de foule. Beaucoup de jeunes, évidemment : il y a encore, à cette époque, des étudiants au Quartier Latin. Cette foule est plutôt joyeuse, on se parle plus facilement qu'avant et qu'après. Chose curieuse, il n'y a pas de flics dans ces rares images qui surnagent ; les cars de CRS resteront liés pour moi à l'après-68, quand M. Harcellin, devenu ministre de l'Intérieur à vie dirait-on, les fera patrouiller des années durant, avec une obstination sénile, dans un Paris redevenu somnolent.
Mon seul souvenir policier me vient d'un autre temps. Fin juin ou début juillet 67, j'ai assisté au dernier monôme de l'Histoire. Pour fêter la fin des examens, garçons et filles, comme chaque année, remontaient le Boul'Mich en masse, occupant toute la chaussée, formant des chaînes, criant des chansons ; à l'entrée de la rue des Ecoles certains ont défait la bâche d'un camion bloqué ; le livreur est sorti fou furieux, a tenté de boxer les rieurs, et même les rieuses, a failli se faire lyncher, s'est réfugié dans sa cabine sous les huées ; j'étais mal à l'aise, je ressentais pour cet homme, et pour mes congénères aussi, un mélange de sympathie et d'aversion écœurant. Quand les flics ont chargé plus tard, boulevard Saint-Germain, les plaisantins ont filé comme des moineaux. Croyant bêtement que je ne risquais rien, n'étant pas du monôme, je suis resté seul, bras ballants, face aux CRS qui m'ont dépassé comme si je n'existais pas. L'un d'eux seulement m'a dit, Poussez-vous donc ! Vous gênez !
Sur l'échelle de Richter des monômes, celui-ci, dit-on, a battu les records. Quelque chose mijotait déjà en 67... La coutume, aussitôt interdite, ne ressuscitera jamais : ce qui suivra l'aura rendue dérisoire.
On parle beaucoup en mai 68, ça je m'en souviendrai. Mes copains m'entraînent, dans la Sorbonne occupée, ce labyrinthe, à la première assemblée générale des classes préparatoires — l'A.G., comme ils disent, déjà initiés. Un certain Kaisergruber, d'un autre lycée, anime sobrement la séance. Pourtant l'affaire traîne en longueur ; nous repartons avant la fin, déjà saoulés de mots. Nous ne le savons pas encore, cette lenteur est délibérée : il s'agit de faire fuir les pékins dans notre genre pour voter tranquillement les décisions entre soi, tard dans la nuit. Le lendemain, ou le surlendemain, Kaisergruber a pris de l'assurance et du style, mais déjà sa voix fatiguée le trahit. Il ne tiendra pas un mois, lâche Roland, pince-sans-rire, tandis que nous quittons la salle plus tôt que la première fois.
Je ne mettrai plus les pieds aux A.G., Radio-prépa me donnant un résumé midi et soir à la cantine du lycée, laquelle fonctionne encore. Un soir, très tard, nous retournons humer le vent dans la Sorbonne voisine. Pénombre des longs couloirs, avec çà et là, entrevu par une porte, un amphi bondé où ça gueule et s'engueule depuis le matin. Un orateur novice exprime d'une voix douce un point de vue modéré ; il est coupé aussitôt ; des stentors quadrillant l'assistance l'insultent, Ferrailleur ! ferrailleur ! (On l'accuse ainsi d'œuvrer à la récupération du mouvement...) L'un des interrupteurs prend sa place, mais je suis déjà parti. Je ne comprends rien. D'autres, qui connaissent les codes et les mots, manipulent tout à notre place.
Les discours, ce mois-là, se doivent de débuter par un vibrant : Camarades !! À la Sorbonne, un autre jour, des étudiants bien comme il faut (on ne dit pas encore BCBG) se fraient un chemin dans la foule en chantonnant d'un ton guilleret, Pardon camarade! pardon camarade ! La mise en boîte récolte des sourires, même parmi les militants. Le croira-t-on ? Certains d'entre eux ont de l'humour, et le garderont parfois jusque dans les moments les plus rudes.
Mais le sentiment sinon dominant, du moins le plus visible, c'est la ferveur, la passion, la rage parfois. Notre ancien prof de philo, Edouard Nadir, a été vu dans la rue s'exclamant : Nous avons dépassé le possible ! Nous sommes entrés dans l'Histoire ! Une foule de commissions se forment, dont une mixte profs-étudiants, incluant certains de nos maîtres, chargée de réformer en quelques jours l'enseignement tout entier. On vous distribue partout des tracts flamboyants, que je me mordrai les doigts plus tard de n'avoir pas conservés. L'un des plus beaux émane d'un mystérieux groupe «marxiste-léniniste chrétien» qui s'en prend aux grands de l'église (Delumière, futur journaliste au Monde, est sûrement dans le coup). Le brûlot s'achève ainsi :
«La clique Ottaviani, Spellman et compagnie a suffisamment craché sur les pauvres !»
Un seul lieu respire la tristesse : notre salle d'étude abandonnée. Finies les révisions d'histoire, les séances de petit-latin ou de petit-grec (l'un traduit à livre ouvert, l'autre suit la traduction et corrige). Les irréductibles polards, s'il en est, se cachent, piochant leurs classiques Larousse, leurs Que sais-je dans des bistrots, des jardins publics éloignés, ou chez eux.
Reste une autre scène, que je ne peux situer dans la chronologie. Comme si elle résumait tout ce mois de mai au point d'en imprégner chaque instant. Une soirée douce, lumineuse, la première où l'on se dit, Tiens, les jours sont longs. Nous avons beaucoup marché, Jacques et moi. Les Tuileries, la Concorde désertes. Le pont barré par des cars de CRS, venus défendre l'Elysée contre l'invasion des bolcheviks, de l'anarchie — la chienlit, comme dit le Prince. Il règne là un silence brutal, tendu, d'œil de cyclone, d'explosion annoncée. Une angoisse comme à la veille d'un examen. Ce mai-là restera, pour beaucoup, le mois de la peur.
Pendant les semaines qui vont suivre, les adultes vont me parler, à moi l'étudiant, avec de l'embarras et même du respect, comme s'il fallait éviter les gaffes, ménager mon éventuelle colère, des fois que je sois un poseur de bombes ou un espion des Chinois. Tout jeune est un révolutionnaire en puissance. Six mois plus tard, quand la vie aura depuis longtemps repris son cours pépère sous un gouvernement plus droitier que jamais, ma mère me confiera que si ça se gâte à nouveau, je pourrai toujours aller terminer mes études en Suisse... Comment leur en vouloir, à nos aînés, de leur malaise, alors que moi-même, témoin privilégié, ami des Contestataires, j'ai connu si souvent la trouille ?
Quand j'ai lu dans la presse le récit de la première soirée terrible, le 10 mai, et vu en photo les cadavres de voitures, j'ai été consterné. Tant de dégâts, pour défendre quoi, obtenir quoi ? N'est-ce pas disproportionné ? Que diraient les incendiaires si on avait fait cramer leur propre bagnole ? Auraient-ils accepté d'y mettre eux-mêmes le feu pour la bonne cause ? Sans doute suis-je «aliéné par mon éducation bourgeoise», trop attaché aux biens matériels, au confort individuel, aux convenances, aux lois ; mes copains, dont le comportement dicte souvent le mien, déplorent cette violence, mais peu d'entre eux condamnent les violents ; je les imite prudemment et m'écrase.
La grève est devenue générale, je crains que l'activité économique paralysée ne mette des mois à se remettre — si toutefois le pays n'en sort pas ruiné. Je pense à la Russie en 1917 : si de Gaulle abdique, si un Mitterrand prend sa place, ne sera-t-il pas un simple Kerenski, chaînon provisoire entre le tsar déchu et les petits Lénine à venir ? Je vois déjà la France en rouge, et moi contraint à l'exil, comme si l'Histoire bégayait, comme si le petit-fils du Russe blanc émigré devait subir, cinquante ans plus tard, le même destin.
Mais ce que je crains surtout pour l'instant, c'est que les cinémas se mettent en grève comme tout le monde. Je suis un cinéphile enragé, contrarié. Pendant trois ans j'ai traversé d'immenses déserts entre les oasis fugitives des concours blancs. Je resterai ensuite en état de manque au moins aussi longtemps. Mon rêve : devenir metteur en scène. En ce temps-là je ne suis pas encore bien sensible au rythme d'une phrase, aux effets de syntaxe, à toutes les subtilités de l'écriture, mais je lis les cadrages, les mouvements d'appareil, le montage, sans effort ; à force de voir des films, chacun d'eux coule en moi comme le sang. Cette grâce plus tard sera perdue.
J'aborde donc ce mois de mai en état de manque, affamé de films autant que de filles. Je suis plus amoureux d'Anna Karina que de toute femme réelle. Entre vivre un grand amour et tourner une grande histoire d'amour, j'hésiterais — et cela ne me paraît pas monstrueux !
Voilà ce que j'aurai fait de plus important à la mi-mai 68 dans Paris bouleversé : voir des films. Tout seul. Autant que je me souvienne, je n'ai pas de copine alors. Les petites salles du Quartier Latin sont vides. Qui voudrait s'enfermer dans le noir avec des fantômes alors que dehors la vie bouillonne, que certains travaillent à la changer ?
Je note minutieusement sur des petites fiches roses, depuis l'âge de quinze ans, les films que j'ai vus, les noms du réalisateur, des acteurs principaux et la date. Pour écrire ce récit je n'aurai pas d'autre document. Du 13 au 21 mai j'aurai vu neuf films en neuf jours, dont trois le 20 et deux le 21. Dans le tas, une seule comédie :
21.5 / Un pitre au pensionnat (1955) / N. Taurog / J. Lewis.
Il faut dire qu'en mai 68 le rire sonne un peu faux.
Certains de ces films seront vite oubliés. D'autres vont rester gravés en moi, comme La mariée était en noir de Truffaut, ou l'injustement mal-aimé Je t'aime, je t'aime d'Alain Resnais, le premier que je vois, le premier jour — au lieu de passer l'écrit, au lieu de suivre l'actualité comme les gens normaux —, dans le ravissement, le remords et l'inquiétude. La sorcellerie à travers les âges, un muet de 1921, sue l'angoisse, mais pas autant que L'heure du loup de Bergman, qui contient deux scènes de pur cauchemar. Le héros est suivi par un homme qui cherche à lui parler ; il le rembarre, le bourre de coups, rien n'y fait, l'autre le suit toujours ; plus tard, sur des rochers surplombant la mer, un enfant presque nu surgit, lui saute dessus ; il se débat, tue l'enfant, le jette à l'eau, mais les cheveux du petit mort surnagent. Le 16 mai au soir, après le film, dans le métro, j'aperçois des copains de mon ancien lycée, je me détourne, pas envie de leur parler, je ne peux me détacher du film, de ces deux scènes qui n'en font qu'une : quelque chose remonte des profondeurs, nous poursuit, ne nous lâche plus.
Demain, la semaine prochaine, y aura-t-il encore des films à voir ? Dans un an, fera-t-on encore de belles œuvres libres, si la révolution l'emporte ? Je suis un drogué s'imaginant privé de sa drogue. Un pessimiste, un défaitiste qui, à l'heure où tout le monde parle de liberté, ne voit dans l'avenir que dictature, censure, propagande. Un type qui a peur de tout.
Mais ma plus grande peur, c'est de laisser voir ma peur. Je joue le sang-froid, le détachement. Je garde pour moi certaines réticences, et je mourrais avant d'avouer qu'au fond je suis plutôt gaulliste. Je pense n'être pas le seul à me cacher. Celui qui, dans notre micro-société khâgnale, s'oppose un tant soit peu à la pensée dominante d'extrême-gauche, est catalogué comme polard, lèche-cul, voire graine de facho. Beaucoup d'entre nous s'auto-censurent comme ils respirent. Au printemps, les types des comités Vietnam ont affiché une banderole au-dessus du tableau noir, un poème traduit du vietnamien :
Magnifique est notre combat.
Mon fusil bien en main
Je rentrerai dans la cité de Ho-Chi-Minh...
Personne n'a protesté contre l'incongru de la chose et la tragique nullité de l'œuvre ; sauf Lompanart, le prof d'histoire, plus inconscient sans doute qu'audacieux ; il a déclenché un vigoureux bzutage collectif. Même les polards ont défendu Ho-Chi-Minh, solidarité khâgnesque oblige, Lompanart a baissé le nez et les autres profs, avertis par lui je suppose, ont détourné les yeux.
Mon hypocrisie en politique et mon amour déclaré du cinéma me valent l'estime de certains militants. J'en suis vaguement gêné. Je ne le mérite pas. C'est clair, je suis un lâche. Qu'aurais-je fait en 40 ? me demandais-je auparavant. La réponse est là : tu te serais écrasé, mon gars. Il est vrai qu'on a d'autant plus de mal à s'opposer que celui d'en face nous est proche et sympathique. Nombre de ces boutefeux sont des garçons brillants, éloquents, parfois chaleureux et charmants, même s'ils tombent parfois dans le farfelu — comme le petit Benoît, qui ne peut vous rendre la monnaie sans invoquer «la scrupuleuse honnêteté chinoise», et qui raconte que les Vietnamiens ont dressé les guêpes à piquer les Ricains ; ou Susong, adorateur de Louise Labé, qui foudroyé par la révélation plaque aussitôt la Belle Cordière pour apprendre par cœur la carte du Vietnam, village par village ; ou André Loblat, le futur philosophe, sapé comme un monsieur, costard cravate et parapluie, démontrant d'une voix douce au prof d'anglais éberlué que Staline était un génie militaire doublé d'un brave type. Comme quoi le ridicule peut toucher au grandiose.
On serait tenté de croire que les «événements» — comme on dira plus tard, faute d'un mot plus précis pour qualifier ce n'importe quoi — que les Événements vont clarifier les positions, à ma gauche les bolchos, à ma droite les fachos, eh bien non. Parfois tout s'embrouille. Peu avant le Concours, notre petit Clebs qui sentait le sol trembler sous ses pas, cessant d'aboyer, nous a lancé en pleine classe le dernier jour que lui n'était qu'un vieux jeton bon pour le rebut, mais que nous les jeunes avions le devoir de tout faire sauter. J'ai honte. Ma bête noire, un vieux réac, m'a doublé sur ma gauche ! En fait c'est moi qui suis vieux, je suis casanier comme un vieux, fringué comme un vieux, veston gris, chemises grises, je ne cours même pas les filles, ou alors faut voir comme.
Une seule pensée me console : à vingt ans, j'en ai quatre-vingt ; eh bien à quatre-vingts, j'en aurai vingt ! Et je serai gauchiste ! C'est à la fin de la course qu'on juge le coureur, et sprinte bien qui sprinte le dernier. Le plus drôle, c'est que j'y crois un peu, et que la suite, bien des années plus tard, ne me démentira pas totalement.
Pour l'instant, que faire à Paris ? Pas de concours avant l'automne. L'insurrection s'installe, prend ses aises et se débrouille fort bien sans mon aide. Un copain nous invite à La Baule, Jacques et moi. Il faut se décider vite : les trains ne roulent plus, on doit partir en stop, mais l'essence devient rare, bientôt les voitures elles-mêmes s'arrêteront.
Le 22 ou le 23 mai à sept heures du matin, mon père nous dépose à la sortie de Versailles. Il a cinquante ans — l'âge que j'aurai en écrivant ceci trente ans plus tard. Il doit être un peu inquiet, mais qu'il se rassure, quant au voyage du moins : mai 68 restera, entre autres, comme l'apothéose de l'entraide et de l'échange, le paradis du stoppeur. Nous n'attendrons jamais plus de dix minutes. Onze heures et sept voitures plus tard, La Baule est à nous. Et surtout, pour se faire pardonner le coup du concours, ce mai généreux nous a offert une exemplaire leçon d'histoire contemporaine. La France entière a défilé devant nous. Ma mémoire en oubliera l'essentiel, et c'est là que je lui en veux le plus, pauvre idiote. Non seulement les gens s'arrêtent, mais ils parlent, ils se confient, comme si, quand se dressent les barricades, certaines barricades intérieures tombaient. D'autant que ces deux garçons inspirent confiance : jeunes mais bien élevés, ils sont également plausibles en pasionarios et en enfants sages, et savent d'autant mieux jouer les deux rôles qu'ils ont pu les étudier longuement tour à tour autour d'eux, si ce n'est au fond d'eux-mêmes.
Prudence : ne pas juger l'homme à ses fringues ou à sa carrosserie. Ce type du côté de Chartres, sapé comme un pédégé, dans un modèle haut de gamme, c'est un syndicaliste CGT grand bouffeur de capitalistes. La camionnette miteuse vers Nogent-le-Rotrou cache un petit patron en salopette, qui nous brosse un tableau idyllique de la libre entreprise et de la France heureuse d'avant le chaos ; l'apocalypse est pour demain, ces connards d'étudiants ruinent le pays, mais attention, je ne dis pas ça pour vous, hein, vous êtes de braves petits gars, ça se voit, si tous étaient comme vous on pourrait se retrousser les manches etc.
Un jeune ténébreux à La Flèche, jeans et blouson, dents serrées, bagnole déglinguée mais rapide encore, accélère à la vue des ouvriers qui font la quête en barrant presque la route. Après Angers, nous nous tassons pour cinq minutes entre des chiens et des fillettes, dans la 4L à bout de souffle d'une dame de bonne famille, veuve et fauchée, triste mais digne, pour qui mai 68 n'est qu'une épreuve de plus imposée par le ciel. Dans la 2CV qui se traîne jusqu'à Nantes, une jeune femme nous écoute les yeux brillants ; on a vite compris que Cohn-Bendit l'émeut davantage que Pompidou ; elle est joyeuse et triste, son petit frère a quitté ce monde juste avant de voir ça, lui qui ne pouvait pas blairer de Gaulle, mais maintenant que ça éclate, et attendez, ce n'est qu'un début, elle se réjouit pour deux. Encore un peu, elle nous remercierait d'avoir fait tout ça pour lui. Elle pourrait bien nous rouler une pelle, on se laisserait faire, mais faut pas rêver, même en 68. Si nous lui apportions la tête coupée du Général, peut-être ?
La lumière est si douce à La Baule, ce soir-là vers six heures, la plage est si belle après les pavés. Nous sommes crevés, saoulés de kilomètres et de parlotes, mais nous avons tenu jusqu'au bout sans gaffe majeure — les classes préparatoires, il est vrai, vous apprennent avant tout l'art de pérorer des heures en exprimant le contraire de vos idées. Et maintenant, après cet oral réussi, les vacances ! Encore plus vacantes d'arriver ainsi sans prévenir, à un moment insolite, et après tant d'années pleines à craquer. C'est la première vraie coupure en trois ans ; jusqu'alors, nos travaux forcés se prolongeaient l'été, vaguement allégés ; cette fois nous n'avons pris ni bouquins, ni cahiers. Juste un peu de français peut-être, de la philo, et de l'histoire évidemment — mais en se cachant l'un de l'autre. Et tout cela restera au fond du sac.
Vertige du vide. Derrière nous les ponts sont coupés : bientôt plus d'essence, on circule de moins en moins. Pas de billet de retour, aucune date limite à l'horizon. Mai 68 a suspendu le temps. Devant nous, la plage et la mer désertes sous le soleil. Ce soleil qui pendant tout ce mois, dans ma mémoire, ne cesse de briller, comme si nous était donné une espèce d'été hors-programme — un été meilleur que le vrai, sans les excès de la chaleur, léger, guilleret, signe que le bon Dieu, qui pour moi existe encore un peu, s'amuse de tout ce tintouin inattendu.
La maison est à deux pas de la plage, côté Le Pouliguen. Nous y sommes au large, et libres comme l'air sans les parents. Le troisième invité, c'est Eric, vicomte de Boncourt, khâgneux lui aussi, un type charmant, encore plus faux-cul que nous, dont je ne saurai jamais ce qu'il en pense, de 68. Notre hôte, Pierre Cossetard, nous le connaissons à peine, pourquoi nous a-t-il invités ? Prestige de nos études ? Etudiant en droit, dix-huit ans seulement, Pierre fait oublier jeunesse et courte taille par un physique massif, un collier de barbe, une pipe. À Paris, veston-cravate. En Bretagne, caban de vieux loup de mer. Quant à ses opinions, au-dessus de son âge elles aussi, lui au moins n'en fait pas mystère : il est là pour défendre la loi, l'ordre et les traditions, comme le lui ont appris ses parents. L'un de ses grands-frères est militaire, l'autre assistant d'un député de droite. Il me lira plus tard une lettre qu'il vient d'écrire à une fille : Moi, j'ai reçu une éducation, annonce-t-il, et non pas, comme la plupart, une instruction. L'été suivant, dans le film que je tournerai en super-8, j'en ferai un commissaire qui devient ministre. Qui a dit que j'étais gentil ?
Alain et Maurice, deux copains de Pierre, arrivent de Cholet où ils ont récolté des patates et des sous pour les ouvriers en grève. Alain Tricoire a un voilier en bois, neuf mètres de long, d'une finesse de lignes admirable, dont il caresse la coque en marmonnant, Bonne bête. C'est clair, il en est fou. Jacques et moi n'avions jamais navigué ; une partie de la journée se passe à tenter de manier barre, voiles et écoutes, ou à vérifier empiriquement le théorème d'Archimède.
La Baule joue les belles endormies. Personne à part nous. Après le dîner on se balade à pas lents sous les pins, entre les villas coquettes aux yeux baissés. Un soir, après avoir poliment dégusté les coquillages ramassés par l'un d'entre nous, toute la bande va prendre un pot. Pour Pierre, ce sera plus d'un. Les coques du dîner, j'imagine, lui pèsent infernalement sur l'estomac comme à nous tous ; cherche-t-il à les dissoudre dans l'alcool, ou simplement à s'anesthésier ? Plusieurs derniers verres plus tard, dans la rue, il rit, chante et culbute avec une souplesse caoutchouteuse — lui si rigide à jeun. Nous saurons plus tard qu'il pratique la cuite à dates fixes, par hygiène, comme dans les pays nordiques. Il attendra d'être traîné chez lui, mis au lit et bordé par nos soins pour dégueuler jusqu'au lait de sa mère. Pendant plusieurs jours, malgré quelques lavages à grande eau, la maison restera imprégnée d'une puissante odeur de coquillages au calva.
Et les filles dans tout ça ? À Paris on écrit sur les murs : Jouissez sans entraves ! La Baule n'est pas au courant. Sur nos sables, dans nos eaux, pas la moindre sirène. Reste le cinéma. Nous allons chercher un peu de rêve dans l'unique salle du coin avec Benjamin ou les mémoires d'un puceau, de l'excellent Michel Deville, bourré de jolies femmes propres à hanter nos nuits, et un film allemand sur le sexe, Helga, pas vraiment cul mais franchement cucul, dont la crétinerie nous laisse atterrés. Jusqu'au samedi où, miracle, nous croisons en ville deux copines de nos copains qui nous invitent à une boum le soir même. Elles sont sœurs, ont notre âge mais travaillent déjà, dans le même bourg du Maine-et-Loire, l'une aux contributions directes, l'autre aux indirectes. L'aînée, Mariette, plutôt bien roulée, tend à éclipser Yvette, sa cadette. La boum n'a rien d'inoubliable, dix garçons pour deux filles, laisse tomber ; Jacques emballe Mariette comme prévu, et je me retire aussitôt. À son retour, Jacques est furieux : Qu'est-ce que tu fous ? La petite sœur a demandé où tu avais filé ! Les filles bavent devant monsieur, et monsieur se tire ! Tu es malade ? Je lui demande s'il trouve qu'Yvette vaut vraiment le coup. Mais bien sûr ! Elle est très bien ! Tu attends quoi ?
Le lendemain soir, les deux Bauloises ressortent, au cinéma, en compagnie des deux étudiants de Paris. Je ne garderai aucun souvenir de Casino Royale, malgré miss Andress. Mieux vaut tenir Yvette que courir Ursula. C'est la première et la dernière fois de ma vie que j'embrasse une fille au cinoche, le dieu des cinéphiles me voit, même dans le noir ; seulement voilà, ce soir-là, ce mois-là, il y a urgence. Le film est de ceux qu'on peut regarder en pointillé, mais j'avoue que là j'aurais craqué même pendant L'Atalante de Jean Vigo, Lola de Jacques Demy ou La nuit du chasseur de Charles Laughton...
Les sœurs ont une voiture. Je ne sais pourquoi elles nous raccompagnent bêtement chez nous, au lieu de nous emmener dans les dunes, ce dont visiblement nous mourons d'envie tous les quatre. Devant la villa des Cossetard, chacun explore un instant sa belle à tâtons dans la bagnole arrêtée. Le lendemain dès l'aube elles repartent au boulot pour la semaine, et le week-end prochain, où serons-nous ?
On se quitte, non sans mal ; j'ai la main trempée des regrets d'Yvette. Les miens sont visibles sur mon beau pantalon clair. Au fait, Jacques, tu sais comment ça s'en va, ces taches-là ?
On ne les reverra pas de sitôt, nos Bauloises. La réalité nous rattrape. Le temps somnolent se remet en marche. Il faut partir.
Ce n'est pas qu'on nous chasse du jardin d'Eden. Pire encore : Dieu le Père s'y invite. Les parents de Pierre, mystérieusement ravitaillés en essence (le député ?), ont débarqué impromptu, flairé l'odeur suspecte, examiné les draps séchant au soleil, interrogé sans grand succès, et rétabli à bord la discipline qui donnait de la bande. M. Cossetard, professeur de mathématiques au Prytanée de La Flèche, puis en math spé à Louis-le-Grand, cheveux blancs, fines lunettes, pas bien grand mais très droit, est un homme à principes ; il croit en l'ordre, la famille, les notes et les classements ; les récents événements ne l'ont guère transporté d'enthousiasme. Mais cette raideur (ses élèves le craignent, dit-on, autant qu'ils l'admirent) est compensée par une gentillesse partagée par toute sa famille, Mme Cossetard en tête. Ces gens-là sont toujours souriants. Quand le père Cossetard vous voit son œil pétille, Ah mon petit Jacques, il a vraiment l'air content, et son fort accent bourguignon, conservé par fidélité aux origines sans doute, par dédain des élégances parisiennes, ajoute au personnage rondeur et bonhomie. Les contestataires lui inspirent une ironie parfois cinglante, que tempère la sérénité d'une conscience en paix avec elle-même. Je le revois gardant la villa, en veston et cravate (ma mémoire exagère, il a sûrement tombé la veste), assis des heures entières sur la dure banquette du salon, sous un rayonnage de vieux livres, à relire Balzac et Stendhal avant l'arrivée des Barbares. Qu'ils viennent : il les accueillera sans peur, la tête haute.
Pourtant il pourrait se détendre : le danger s'éloigne. Le 30 mai en fin d'après-midi nous sommes sur la plage immense, Jacques, Pierre et moi, autour d'un minuscule transistor, quand de Gaulle se décide à parler. On le disait envolé en hélicoptère ; là aussi, Dieu revient se poser parmi nous. Et là encore, finie la rigolade. Même pas besoin d'écouter ce qu'il dit : le ton de sa voix suffit. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, cette voix-là, on ne peut l'entendre sans une terreur sacrée. Mitterrand, qui parle juste après, ne fait pas le poids ; il se sait vaincu, on le sent. Le même soir, un raz de marée humain déferle sur les Champs-Élysées. Plus d'un million de braves gens qui n'en pouvaient plus d'avoir peur. Eux aussi savent marcher dans la rue, non mais alors ! Que la revanche doit être douce. Dès le lendemain la révolution retombe comme un soufflé.
J'avoue : la voix du père, ses enfants rassemblés, tout cela m'a fait du bien. Je souhaite que le pays se remette au travail, sous un gouvernement démocratique, de quelque bord qu'il soit, qui procèdera en paix aux réformes s'imposant le plus. Quand la droite au pouvoir, quelques semaines plus tard, obtiendra un triomphe aux élections, j'en serai plutôt satisfait. Et quand j'apercevrai, vers la même époque, le politicien de droite pour lequel travaille le frère de Pierre, je serai encore impressionné. Jeune mais pas trop, actif, sûr de lui — passons enfin aux choses sérieuses, après toutes ces mômeries —, X. est conforme au portrait extasié des Cossetard. Presque trop : une scène m'a vaguement gêné, qui plus tard, quand j'aurai viré de bord, fera tourner cette journée d'euphorie comme une mayonnaise : X. confiant sa voiture à son chauffeur et courant derrière en pantalon de toile et sandales, poussif, suant, grassouillet à trente-cinq ans, pour montrer combien il est dynamique. Ah, «dynamique». Ce mot, il l'incarne si pleinement, si grotesquement, que je ne pourrai plus l'utiliser sans que la honte m'envahisse de m'être ainsi laissé bluffer par du toc. Je dirai à ma décharge que jamais avant lui je n'avais rencontré d'homme politique.
C'est ce jour-là, je crois, qu'est plantée en moi la première graine qui me fera pousser plutôt à gauche. Je deviendrai progressiste, mais progressivement, un atavisme chassant l'autre — le familial cédant au professionnel. Quant à mai 68, je ne saurai jamais quoi en penser. Superbe ? minable ? Historique ? insignifiant ? Bénéfique ? inutile ? En fait je ne l'aurai vraiment découvert, et vécu de l'intérieur, que dix ans après tout le monde, en voyant au Saint-Séverin (ou aux Trois Luxembourg ?) Mourir à trente ans de Romain Goupil. J'en suis sorti en larmes ; dans ce montage de bandes d'actualités et d'entretiens, dans la ferveur amère du commentaire, j'ai trouvé l'âme de ces journées. Je n'avais vu que la farce ; j'ai découvert la passion, la grandeur, le tragique. Et c'est justement cette double face que j'aime dans mai 68. La confirmation éclatante que tout est insaisissable. Les naïfs qui portent 68 aux nues, s'il en est encore, m'agacent, mais les malins qui le débinent me font un peu pitié. Car conne est la jeunesse, hélas, mais ceux qui la trouvent conne encore plus.
Retour à La Baule — plus pour longtemps. Le mois de juin a commencé, mais ce qui va suivre poursuit et conclut l'histoire de mai. La France est repartie. Finies les grèves, l'essence coule à flots, les trains roulent, Jacques nous quitte pour son Perpignan natal où les révisions l'attendent. Moi aussi, polard entre tous, mon surmoi me tire par la manche, assez rigolé, au boulot.
Tout de suite, vraiment ? Les copains de Pierre m'invitent en croisière. La Baule-Brest. Toute la côte bretonne du sud. Quatre garçons, deux bateaux. Une occasion unique. Offrons-nous cette ultime — et première — folie.
Nous avons fait, en guise de répétition, une virée jusqu'à Noirmoutier. L'odeur des sardines grillées mélangée à la puanteur de la coque en plastique m'a flanqué un mal de mer infect. J'ai compris que la navigation à voile était la plus belle et la plus horrible des choses, mais j'ai réussi à ne pas gerber, à ravaler l'infamant malaise aussi parfaitement qu'à Paris mes opinions politiques.
Et maintenant, cap à l'ouest ! Départ dans le soleil couchant, vent arrière, à grande allure, sur une houle qui secoue la barre comme une bête nerveuse. La nuit nous rattrape ; jusqu'au matin nous filons ainsi, scrutant les lueurs des phares qui tournent chacun à son rythme, et des balises fixes dont les signaux changent suivant notre position. On croise ainsi, dans l'alignement de deux feux, ou dans le passage d'un double éclat jaune à un vert permanent, des lignes invisibles qui nous situent dans ce désert noir. On est à la fois dans un espace on ne peut plus concret, physique, prêt à nous submerger, et dans un autre magiquement abstrait, sans épaisseur, où l'on n'est plus qu'un point entre d'autres points que relient des lignes, une figure de trigonométrie animée. Une fusée parmi les étoiles. Bien plus tard, en traduisant des poèmes obscurs, je repenserai à cette nuit en mer, à l'angoisse légère mêlée d'allégresse, le tâtonnement et l'infini.
Le jour se lève, le vent tombe. Longues heures de calme nauséeux, voiles flasques, mer plate, collante. Après la nuit blanche, les sommeils de midi. On siffle le vent, il se remue un peu, se rendort. Un ou deux jours passent, mélangés dans le souvenir. À Concarneau, on fait la vaisselle dans les eaux grasses du port. On petit-déjeune l'après-midi dans un bistrot où quelques habitués s'interpellent et chantent, si imbibés qu'on pourrait allumer leur haleine au briquet. Tout le répertoire des années 30 et 40 y passe, Riquita jolie fleur de java et autres, les chansons de maintenant ça ne vaut pas tripette, ah le bon vieux temps, ah les grèves de 36, ça au moins, et ces petits cons de gauchistes, des baffes, on va leur montrer, nous. Le centre du monde, c'est leur bistrot, ils détiennent le secret de la vie, et ça les rend joyeux, invincibles. L'un d'eux crie fièrement son nom comme un titre de gloire : Albert Morieux ! Ma mémoire, qui a laissé filer tant de moments précieux, va retenir ce nom-là. Trente ans plus tard, en écrivant ceci, je chercherai Albert Morieux de Concarneau sur le minitel. Je serais même fichu de l'appeler, s'il n'était pas sur liste rouge.
Nous repartons en mer comme des zombies. Nous confondons un peu les heures, le jour, la nuit, et voyons dans cette confusion l'ultime effet de la grande déglingue de mai — bien que cela vienne peut-être avant tout de la mer, où les repères s'effacent, où le temps fait n'importe quoi. On longe les Glénans, puis les rochers de la pointe du Raz, si longue ; en franchissant le cap on se dit que ça y est, on est au bout de tout, maintenant commence le retour.
La fin de l'étape est mouvementée : Maurice et moi, sur le bateau le plus lent, pris dans le reflux, manquons repasser la dangereuse pointe à reculons ; puis nous devons, dans la nuit noire, atteindre la baie où l'autre bateau nous attend sans nous fracasser sur les rochers à son entrée, les fameux Tas-de-Pois. Maurice est à la barre et moi, couché à l'avant comme une figure de proue, la lampe de poche au bout de mon bras tendu, je scrute la nuit noire. Maurice m'avouera plus tard qu'il était mort de trouille. Moi, rien. J'ai laissé la peur à Paris. Est-ce grave de mourir, quand on n'a pas d'enfants ?
Le lendemain à Brest, fin du périple. Pierre et moi laissons les bateaux aux deux autres et repartons en stop. En fin d'après-midi, au Faou (prononcer : fou), nous prenons un thé dans une auberge. La fille au bar, dans les vingt ans comme nous, semble nous trouver sympathiques. Vous allez faire du stop la nuit ? Vous êtes cinglés ! Pourquoi ne pas rester ici ? Je peux vous héberger chez moi, on passerait la soirée ensemble, j'ai ma meilleure copine à côté, je lui téléphone... Elle me plaît, cette fille. Elle s'appelle Malou. La copine, prudence, on ne l'a pas vue, mais c'est peut-être moi qui hériterai de Malou — à condition que Pierre... J'observe mon acolyte. Sur le bateau nous avons parlé des filles. Pierre a des principes. Pas question de faire le faou avec n'importe qui. Rien que du sérieux, du solide. Malheureusement nous sommes pressés, répond-il, baissant les yeux pour éviter les poignards qui sortent des miens.
Malou ne s'avoue pas vaincue. Après avoir insisté encore, elle propose de nous déposer du moins en voiture quelques kilomètres plus loin, à la grande route de Quimper, dès qu'elle aura fini son service. Pierre, que je mitraille du regard, juge préférable d'accepter. À huit heures du soir nous quittons l'auberge dans la petite Austin de Malou. La copine, arrivée entre-temps, pas vraiment un canon, s'est sapée comme pour le bal, dans une robe si mini que son panty dépasse quand elle hausse les sourcils.
Malou a rempli notre thermos de soupe. La nuit tombe le plus tendrement qu'elle peut. J'essaie de garder espoir, de bricoler une stratégie. Laisse tomber. Pierre a pris son air buté de marin breton, fermé les écoutilles. Non seulement le paradis va me filer sous le nez, mais je vais passer pour le roi des nuls. Ou le vice-roi. Comble de déveine : un camion s'arrête aussitôt, davantage pour Malou que pour nous sans doute, mais les deux mecs vont monter seuls, pour leur châtiment, dans le bahut le plus sale de toute la Bretagne, dont le chauffeur ne cessera de jurer toute la nuit, grinçant ses vitesses, Vingt dieux de vingt dieux de vingt dieux de pompe à merde ! J'y ferai de nouvelles taches à mon pantalon clair — de soupe et de cambouis cette fois.
J'arrive à Paris vers le 15 juin et replonge dans mes révisions jusqu'à l'automne.
Plus tard j'ai perdu Pierre de vue. Il s'est marié (vierge ou non, je l'ignore), il est devenu avocat-conseil ; plus tard encore il nous a invités Jacques et moi, flanqués de nos épouses, dans son immense appartement de l'avenue Marceau. Le père Cossetard était là, souriant, immuable comme sont les archétypes. Jacques travaille dans l'industrie, Roland dans la culture. J'enseigne l'anglais dans un lycée de banlieue. J'ai rencontré Yvette deux fois, fin 68 et début 69, c'était bon, puis plus rien ; elle vit à Nice, je crois, avec un vieux mari friqué. Malou ? Jamais revue.
Malou, Malou, je n'ai pas coutume de regretter le passé, je pense peu souvent à mai 68, et sans nostalgie, mais quand j'y pense je ne vois pas de Gaulle ou Cohn-Bendit (ni toi d'ailleurs, j'ai oublié ta bouille), je vois ton Austin au bord de la route et le camion pourri qui s'arrête. Des filles, j'en ai raté bien d'autres depuis, et ce n'est pas fini, mais comprenne qui pourra, tu es la seule dont j'aie du mal à me consoler. Et c'est pour toi sans doute que j'ai écrit cette histoire, sachant qu'elle me mènera une fois de plus vers l'auberge où tu me tends la main, cette main qu'à chaque vision du film, image par image, comme un idiot, j'essaie encore de saisir.
Été 98
Rencontres avec les dieux a été publié avec d'autres textes dans Eden et environs, aux éditions des Vanneaux.
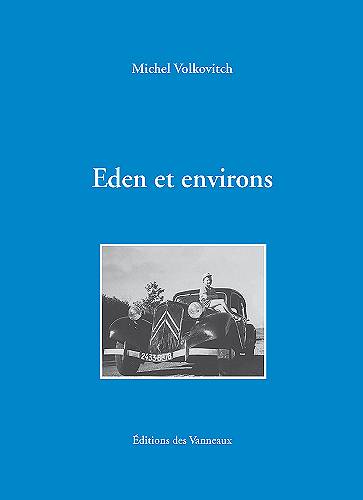 |