
Le château de Saumur.
BRÈVES
N°237 Juillet 2023
L'avantage de passer sa vie à tapoter le clavier entre des murailles de livres, c'est que la moindre échappée prend des proportions mirobolantes. Or le hasard a voulu que l'ermite, lors de ce dernier mois, soit tiré deux fois de sa tanière.
Parmi les traditions familiales, il y a la virée à vélo annuelle en compagnie de mes fistons, la distance étant égale au nombre de mes années. Nous en sommes donc à 75 kilomètres. Cette fois nous avons roulé au bord de la Loire, fleuve pépère dont les rives plates et bien aménagées sont idéales pour un vieillard. Après quoi, bien logés dans un étonnant airbnb troglodytique, nous aurions pu rester quelques semaines sans épuiser les beautés de la région.
Je raconte dans le Journal infime du mois («Volatiles volubiles») l'extraordinaire zoo de Doué-la-Fontaine, mais que dire des châteaux ! Un prospectus en recense une centaine aux alentours du fleuve et nous en avons visité seulement deux. Celui de Saumur, si puissant et si fin, trône dans les Très riches heures du duc de Berry où l'on dirait un palais imaginaire, un rêve. Le rêve a traversé les siècles, quasiment intact, et l'on n'en croit pas ses yeux. L'intérieur n'a rien de passionnant, hélas, et je n'ai pas été moins touché par le château de Montreuil-Bellay, non loin de là, dont j'ignorais jusqu'au nom. Encore un château-palimpseste, où la Renaissance corrige le Moyen-âge ; moins impressionnant certes que Saumur, mais bien mis en valeur, aménagé intérieurement avec amour et dominant une charmante rivière.
 Le château de Saumur. |
Camp de base de notre rando cycliste : Saint-Florent-le-Vieil, fief de Julien Gracq, lieu hanté où j'aime tant revenir. En mourant, l'écrivain a fait de sa maison une résidence pour écrivains, et j'ai eu l'idée, avant de pédaler le lendemain, d'inviter à dîner les deux pensionnaires du moment. Je ne les connaissais pas ? Raison de plus pour les rencontrer. Je me suis dit qu'ils avaient sans doute un lien avec leur hôte, que nous avions donc des chances de bien nous entendre, et j'avais vu juste : Clara Arnaud et Olivier Domerg, fort sympathiques par ailleurs, auraient beaucoup intéressé le géographe passionné qu'était Gracq.
Quelques jours plus tard, je les ai lus, bien sûr.
Clara Arnaud, à vingt-et-un ans, a traversé à cheval et à pied le Far West chinois, du pays ouïgour au Tibet. Elle en a tiré son premier livre, Sur les chemins de Chine, publié en 2010 chez Gaïa. On y retrouve les grands thèmes du récit de voyage : paysages fabuleux, souvent terrifiants (ici, déserts immenses et villes frénétiques), bonnes et mauvaises rencontres, morceaux de bravoure (la course de chevaux où la jeune femme affronte les rudes cavaliers locaux, la cérémonie où l'on invoque les esprits), montagnes russes entre extases et déprimes, réflexions sur le voyage, lequel tourne à l'expérience spirituelle, à l'épreuve initiatique. Bref, on a là le meilleur du genre, profondément senti et pensé, fermement écrit. Mais si le but du livre était d'inciter à visiter ce camp de concentration qu'est la Chine, ou ce pays martyr qu'est désormais le Tibet, ce serait raté...
Morceaux choisis :
La Chine m'envoie de violents coups de poing en pleine figure, elle me brutalise, elle ébranle mes convictions, broie mes rêves, annihile mes espoirs et ne donne rien de ce que j'attendais d'elle. Je me sens sale, fatiguée, démunie et ses coups continuent de pleuvoir.
Le plus difficile est de laisser, au rythme de ses pas, le temps s'appesantir, la distance s'étaler paresseusement, le monde se déployer dans son insondable immensité, laquelle me ramène inexorablement à ma propre insignifiance.
Insignifiance qui s'impose comme une cruelle réalité, me faisant craindre de perdre pied, perdre la tête dans des pensées sans fond et sans fin qui confinent à la folie.
La route vous encrasse, puis elle vous atomise, vous émiette, vous diffracte pour mieux vous offrir sa leçon.
Mon corps pourrait continuer l'effort des mois durant, ma tête ne veut plus marcher. Or la marche est avant tout un exercice mental, une expérience spirituelle. Bien plus que les courbatures, c'est la lassitude qui est à craindre, et bien plus que les kilomètres accumulés, c'est soi-même que l'on parcourt.
Clara Arnaud, par la suite, a vécu en Afrique avant de s'installer en Amérique latine. Et ensuite, où ?
 Clara, Zéphyr, Éole |
Olivier Domerg ne voyage pas aussi loin, même si l'écriture l'a mené naguère jusqu'à New York. Peintre en paysages — peintre avec des mots —, il explore avant tout certains coins de notre pays. Pour écrire La Verte traVersée (L'Atelier contemporain), il a parcouru le Cantal en voiture plusieurs fois, au printemps, prenant des notes d'où est sorti ce livre étonnant. Il décrit ces montagnes paisibles minutieusement, avec une douceur obstinée, car il faut un labeur infini pour traduire le paysage en mots, pour approcher la profusion du réel, pour que «le monde se livre» — autrement dit, qu'il se donne et se change en livre.
Ces pentes rassises et proprement
Rapiécées, et comme crochetées
Par tous ces ressauts, tous ces bourrelets
Des anciens murets et restes de haies ;
Par ces infléchissements du relief
(Traits de fractionnement et de rupture,
Vieux tassements et vieilles cassures)
Qu'atténuent la vêture herbeuse
(«Cette vertu émolliente du vert»)
Et la vision des montagnes au loin !
Le titre annonce la couleur : l'ensemble est une longue célébration du vert (celui de l'herbe, des feuilles, de la jeunesse, de la vigueur) et du vers qui le dépeint avec une exubérance inlassable, joueuse, printanière, une ver(t)ve pour tout dire. C'est de la poésie : 455 dizains de dix syllabes, structure stricte a priori, mais assouplie par des rimes et des rythmes mouvants, des coupures de mots et tout un jaillissement d'inventions langagières.
Quelque chose qui vous réconcilie
Ou console de la «marche du monde».
Vous êtes au bord : l'herbe est «une eau verte»
Dont on voudrait bien pouvoir fendre l'onde !
Voilà ce qui vous vient à la seconde
Devant cette étendue rutilante.
Tant de VERT iridescent. Tant de VERT
Matérialisant les formes pleines ;
Creux et rondeurs des reliefs assoup(l)is.
Tant de VERT vous délivre de vos peines.
C'est une promenade et en même temps une recherche, et c'est surtout le récit d'une rencontre heureuse avec le monde.
Les belles photos de Brigitte Palaggi viennent confirmer en fin de volume la conformité du réel à sa peinture, mais même sans elles, rien que par les mots on est déjà là-bas, au cœur du Cantal, à tourner les pages du paysage, ce grand livre ouVert.
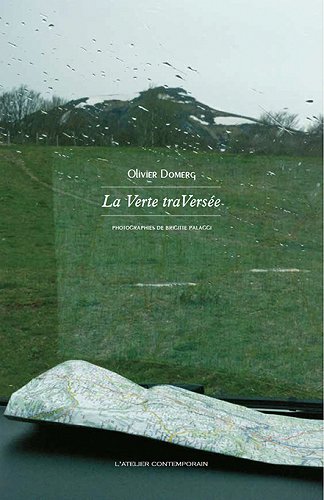 Vers le Cantal. |
Il n'y a qu'un pas du Cantal au Périgord où Pierre Michon nous attend avec son dernier livre : Les deux Beune (Verdier). Nous sommes dans la province française des années soixante, et en même temps (par un jeu d'allusions fugitives) dans d'autres parties du monde et d'autres époques (la préhistoire surtout avec ses cavernes toutes proches). Face au tout jeune instituteur qui débarque, une femme qu'il désire aussitôt avec frénésie, quelques paysans minables et superbes, dont un étrange pêcheur, des animaux, bêtes et poissons, très présents, le personnage principal étant Sa Majesté le désir : ce qui se joue dans ce trou perdu entre deux rivières minuscules, c'est l'universelle et éternelle histoire, l'origine du monde,
cette enflure, cette brûlure, qui jette les plus jeunes vers le drame et la nuit, les avilit et les sacre, les fait à quatre pattes se perdre de plaisir, et à quatre pattes aussi et à peine moins hurlantes se perdre d'autres fois de douleur, de deuil, de misère.
J'avais lu à sa sortie, en 1996, la première partie de ce roman : La grande Beune. La seconde, parue vingt-sept ans plus tard, semble encore plus obscure, incandescente, forcenée. Dans la pluie, le brouillard et la nuit noire, des apparitions :
Il sortait donc du brouillard et passait la porte avec ce sourire à soulever les filles, lui qui ne soulevait que les carpes, (...) silencieux sur les souples pataugas, les cheveux d'Indien dégoulinant en mèches sur le front, flou d'expression mais tout sourire comme si le brouillard même avait souri.
Et la femme :
...le chignon apprêté, la masse de jais haute et troussée sur la nuque, les sequins dans ce jais, l'écarlate aux pommettes, aux lèvres, la paupière guindée de bleu, tout lui composait ce masque que Sumer a cherché, que Mycènes a cherché, que je suppose Cro-Magnon a cherché, et qu'a trouvé et porté à sa perfection Hollywood dans sa grande période.
On imagine Michon travaillant pendant près de trente ans cette matière en feu — à moins qu'il n'ait dû sans cesse la lâcher, tant elle brûlait les doigts — jusqu'à lui donner cette densité effrayante, d'une étouffante beauté.
 Pierre Michon aujourd'hui |
Passer du Périgord noir de Michon à la Bourgogne claire et pieuse de Marie Noël, c'est un sacré grand écart. Pourquoi ce besoin de courir à Auxerre, les Beune à peine quittées ? Pour souffler un peu sans doute.
Dans Petit-jour (Stock), publié en 1964 peu avant sa mort, la poétesse raconte son enfance avec sa simplicité, sa tendresse et sa dévotion coutumières. Ici, pas la moindre trace de sexe, bien sûr. La marguerite qu'elle effeuille ne parle pas d'amour, mais lui révèle son destin : «Fille, femme, veuve, religieuse». Les grands moments pour la petite Marie sont les fêtes religieuses et la première communion. Pas vraiment mon truc, tout cela, mais comment ne pas être ému par ces émerveillements candides ?
Le jour de la Fête-Dieu,
les cloches de la Cathédrale, au lieu de tinter pieusement comme d'habitude à l'aurore sans seulement nous réveiller, se lançaient dès l'aube à plein ciel, dans une allégresse immense qui bondissait, rebondissait et nous enlevait le cœur en fête avec elles.
Elle avance alors
dans l'église magnifique, entourée toute de musique, de parfums et de lumières, comme une sainte au Paradis.
Il suffit d'une promenade en forêt
où je sus, sans demander rien, que nous avions très loin perdu les pays ordinaires et pris un sentier mystérieux dans la profondeur inconnue du monde.
Comment ne pas être touché, de même par cet humble autoportrait :
...tout un air convenable et ingrat que j'ai, sans penser à mieux, gardé terne comme il était jusqu'à environ la quarantaine, prise en défaut de santé, de beauté, de charme et d'adresse à toutes les rencontres du monde, petite passante incolore, étrangère au chemin qu'elle suit... Mais gaie dans la Maison intime, parfois, comme une âme de deux sous qu'amuse un petit oiseau drôle.
On remarquera— ou pas — que ces phrases apparemment limpides cachent des écarts infimes qui leur ajoutent un charme subtil, comme dans cette phrase :
Nous partions au bonheur de la matinée — chapeaux de paille, robes de toile fraîche.
Phrase très savante mine de rien, qui m'enchante.
 À l'âge où elle écrit ses mémoires. |
Nadeau a-t-il écrit sur Marie Noël ? Je consulte l'immense index à la fin du troisième et dernier volume de Soixante ans de journalisme littéraire, où son fils Gilles a recueilli (aux éditions portant son nom) tous ses articles. Non, rien. Pas étonnant : Marie et Maurice avaient peu de choses en commun...
J'arrive à la période (1986-1990) où j'ai connu Nadeau et commencé à le fréquenter. Dans ces nouvelles pages, peu de noms inconnus à découvrir, si ce n'est Maurice Girodias, aventurier, éditeur pornographe, congénitalement non-conformiste et provocateur qui publie alors des mémoires fort appréciés : Une journée sur terre (La différence).
Nadeau tresse des couronnes à la bio de Trotsky par Pierre Broué (Fayard), est emballé par Claudio Magris qu'il découvre (Danube, à l'Arpenteur), salue chaleureusement Tu ne t'aimes pas, de Nathalie Sarraute (Gallimard), qui restera méconnu, loue à nouveau Guy Dupré pour ses Manœuvres d'automne (Olivier Orban) et dit du bien de Jacques Prévert alors que les snobs, dit-il, s'en détournent. Il fait de Breton, à propos de Nadja, un éloge nuancé :
La vie, l'amour, la poésie, le merveilleux quotidien et de mystérieux appels vers l'inconnu, c'est ici que magiquement ils cristallisent. C'est ici que Breton, plus que dans nombre de ses poèmes, éclatants d'images mais souvent essoufflés et entachés de préciosité, se montre à la hauteur de ses ambitions.
Mais ce que je retiens surtout dans cette tranche de quatre années, c'est quelques petits coups de patte vachards, dans lesquels Nadeau excelle.
Il loue, soixante-dix ans après sa parution, le Paysan de Paris d'Aragon, «poète dont on ne finira pas de regretter qu'il soit mort trop tôt».
Lorsque paraissent les Lettres à Sartre de la grande Simone (Gallimard), il s'en amuse :
Ces produits de Normal' Sup' et de l'agrégation de philo, enseignants par nécessité, se veulent écrivains qui marqueront leur temps, et s'ils s'envoient des lettres, c'est en pensant à cette postérité qu'ils disent mépriser.
Il emprunte à Magris une scène succulente : Gorki et Malraux parlent de Dostoïevski. Le premier : ce n'était rien qu'un «théologien et prédicateur». Le second : permettez, il y avait chez lui «quelque chose de valable» : «son sens de la solidarité et de l'avenir».
Conclusion de Magris : «Nul n'a réussi mieux qu'eux à ne rien comprendre à la littérature».
Et moi j'ai encore dans les oreilles le petit rire de Nadeau.
 Nadeau chez lui, avec son chat. |
Arthur Koestler, Nadeau en a parlé abondamment quand celui-ci eut son heure de gloire, après la guerre. Ce révolutionnaire déçu par le marxisme écrivit alors quelques livres, dont Le zéro et l'infini, encensés par la droite qu'il ne cessa jamais de combattre et sauvagement insultés par les staliniens du monde entier. J'ai trouvé dans la bibliothèque de mes parents, qui n'étaient pas précisément cocos, Le Yogi et le Commissaire (1946), recueil d'essais écrits pendant la guerre, traduit de l'anglais par Dominique Aury et Jeanne Terracini.
Nadeau explique le titre mieux que moi : il y a d'un côté «l'idéologie du Commissaire pour qui l'homme est une matière malléable que l'Extérieur peut transformer en le conditionnant différemment», et de l'autre «la doctrine du Yogi pour qui toute transformation vient de l'Intérieur, dans une contemplation des lois de l'Univers». Pour Koestler, le salut est dans une synthèse des deux, et faute de pouvoir révolutionner le monde, le nouveau mot d'ordre est «Pessimistes de tous les pays, construisez des oasis». Conseil plus raisonnable que jamais.
On trouve plus loin une belle définition du fascisme :
Partout où l'on parle de sidis, de youpins et de sales nègres, partout où l'on espionne, officiellement ou officieusement les mœurs amoureuses et les crédos politiques des citoyens, partout où l'on appelle Péril Rouge les revendications ouvrières et où une grève légale est brisée à coups de mitraillette et de matraques, le Fascisme est là.
Certains termes ont changé, le prolo rouge a nettement bruni, mais le reste n'est-il pas, si l'on pense à notre police violente et raciste, d'une actualité cruelle ?
Surprise : je croyais lire un essayiste clairvoyant, je découvre en prime un écrivain. La page sur le visage d'Hitler est une splendeur :
...il s'en dégageait quelque chose d'horrible et de grotesque comme des masques totémiques portés aux danses rituelles qui accompagnent les sacrifices humains.
Koestler a beau dire qu'«une phrase maladroite est souvent plus près de la vérité qu'une phrase simple et élégante», il le sens de la formule, du raccourci, et l'art d'illustrer sa pensée par des images bien senties :
Le secret du Fascisme est bien dans le retour aux croyances archaïques dans un cadre ultra-moderne. L'édifice nazi était un gratte-ciel dont le chauffage central était alimenté par des sources chaudes d'origine volcanique.
L'idéal de l'état démocratique, quand il fonctionne bien, est le même que celui des vêtements bien coupés — on ne doit pas le remarquer.
Pendant les quinze dernières années, ces chevaliers aux armures rouillées, qui portaient sur leurs boucliers les mots Liberté, Égalité, Fraternité se sont toujours battus du côté des vaincus.
Sommes-nous mieux lotis aujourd'hui, pauvres Don Quichotte, face aux ennemis de la démocratie, déclarés ou hypocritement cachés ?
 Arthur Koestler, juif hongrois (1905-1983). |
Ma seconde vadrouille du mois ?
Comment l'oublier ? C'était d'abord à Lyon, où les Nuits de Fourvière accueillaient de nouveau, neuf ans après, le chant rebètiko. Trois ensembles très différents, trois bonnes heures de bonne musique, une organisation parfaite signée Dominique Delorme, âme de ces lieux, et un public de connaisseurs venus en foule. C'était l'occasion de retrouver — ou de découvrir — certains fidèles lecteurs du Miel des anges. Les deux volumes de La Grèce de l'ombre sont partis comme des petits pains.
De Lyon à la Suisse, berceau de ma famille maternelle, il n'y a qu'un pas. Un pèlerinage s'imposait, à Genève d'abord chez ma tante Maryse et mon cousin Marc (oui, le maître de toile du site !), puis à Vevey où mon arrière-grand-père fut vétérinaire et où vivent aujourd'hui Jean-Marie et Simone, autres délicieux cousins. Mais j'évoquerai une autre fois ma chère famille ; pour l'instant, place à deux moments forts vécus à Lausanne dans la même journée.
Visitant la cathédrale, tombés par hasard sur l'excellent orchestre de chambre local répétant la Messe en ut mineur de Mozart, la première œuvre avec orchestre que j'aie chantée, il y a cinquante ans. Je ne la savais pas aussi belle. La musique classique ne nous bouleverse jamais autant que lorsqu'elle nous est donnée ainsi à l'improviste, et si les hommes n'avaient pas inventé le paradis bien avant la naissance de Mozart, on pourrait dire que sa musique leur en a soufflé l'idée.
Le même jour, tout en haut de la ville, la fameuse collection de l'Art brut est à la fois une montée vers les cimes et une descente aux enfers. Je l'avais visitée une première fois à son ouverture en 1976. Les œuvres de ces artistes pour la plupart autodidactes, isolés par la pauvreté, la maladie ou la folie, sont le plus souvent saisissantes, parfois jusqu'au malaise, de même que leurs notices biographiques accrochées à côté, qu'on lit le cœur serré. Cette fois j'ai craqué pour Madge Gill, dont les dessins sont hantés par un même visage de femme jusqu'au vertige.
J'ignorais tout de Michel Nedjar qu'une expo accueille là-haut en ce moment. Il n'est pas brut au sens strict : bien qu'il n'ait pas étudié la peinture, on sent qu'il a beaucoup regardé les œuvres des autres. Il fait de l'art brut — et quand bien même ? Son travail est d'une force indéniable (terrifiantes, ses poupées), d'une variété étourdissante, et son atelier foutraque, débordant, qu'on voit en photo, est à lui seul une œuvre d'art.
Il faut voir la collection de Lausanne une fois dans sa vie, et deux fois c'est encore mieux : www.artbrut.ch
 Jusqu'au vertige. |
Et puisqu'on parle de folie...
Laure Murat consacre chez JC Lattès un livre à La maison du docteur Blanche. Les grands lecteurs connaissent de nom cette maison qui accueillit au XIXe siècle à Paris une flopée de malades mentaux célèbres, de Nerval à Maupassant, sans oublier Gounod, Marie d'Agoult et Théo Van Gogh, frère de Vincent.
Passionnante lecture, à plus d'un titre. Ce livre copieux mais digeste, précis mais vivant, analyse les causes de la folie à l'époque, offre un tableau du traitement de la maladie mentale en ce temps-là — terriblement primitif et brutal encore — et rapporte les progrès qu'y apportèrent dans leur institution les deux docteurs Blanche, père et fils. Progrès fort limités, guérisons très rares, mais le portrait nuancé d'Émile Blanche le fils fait apparaître un homme d'une remarquable humanité — la seule personne que les Goncourt, dans leur journal, n'aient jamais critiqué !
À noter un chapitre gratiné sur «La folie au féminin». Extrait :
On est en droit de se demander si les femmes ne sont pas, dans l'esprit de la bourgeoisie au pouvoir, condamnées par nature à la folie : «Toute femme est faite pour sentir, et sentir, c'est presque de l'hystérie», déclarait l'aliéniste Ulysse Trélat, en un saisissant raccourci de l'opinion générale.
Aux États-Unis, en 1860, une femme qui enseignait dans ses cours d'histoire sainte que l'homme est naturellement bon (et le péché originel alors ?) fut envoyée à l'asile par son mari pasteur.
C'était la saillie anticléricale du mois. Qu'on me la pardonne : la religion ne l'a pas volé.
Le livre de Laure Murat nous raconte aussi, naturellement, l'agonie atroce, interminable de Maupassant, et l'on suit avec chagrin le naufrage du doux Gérard Labrunie qu'on ne peut qu'aimer comme un frère. Est-ce la folie qui a fait de lui le génial Nerval ? D'après Claude Pichois, cité ici, «on ne peut pas dire que c'est la folie qui l'a fait poète. Poète, il l'était, de naissance. Mais les conditions auxquelles était assujettie la poésie française empêchaient le Nerval profond de se révéler. La folie a brisé les entraves.» Et Charles Asselineau : «Gérard a eu besoin, pour oser être vraiment poète, de l'exaltation fébrile de la maladie».
Mais qui est prêt à payer le génie à ce prix ?
 L'hôtel de Lamballe, alias Maison du docteur Blanche. |
Feydeau mourut fou, sans qu'on puisse voir un lien entre sa maladie mentale et le vent de folie qui fait tourbillonner ses pièces. Dans Occupe-toi d'Amélie !, la dernière en trois actes, il ajoute à la cascade de quiproquos habituelle, qui rend l'action pratiquement inrésumable, une troublante confusion des rôles familiaux et sociaux : Amélie passe de la prostitution à la respectabilité bourgeoise, son frère est en même temps son domestique, etc. etc. Les personnages ne cessent de mentir et de se duper les uns les autres, jusqu'à la confusion totale, ceux qui ont combiné un faux mariage se retrouvant mariés à leur insu ! Ils en restent sans voix — et le spectateur donc.
 Georges Feydeau jeune. |
Côté BD, ce mois-ci, un Tati et le film sans fin où Arnaud Le Gouëfflec et Olivier Supiot racontent la carrière du génial cinéaste de façon agréable. Un bon début avant de passer à des approches plus complètes avec texte et photos, comme le Tati de David Bellos au Seuil ou celui de Marc Dondey chez Ramsay.
Dans les salles, encore un mois pauvre pour nous, quantitativement du moins, malgré une offre toujours abondante.
Love Life (2022) du Japonais Kôji Fukada : une femme perd son jeune enfant, retrouve son ex, découvre l'ex de son mari, dans un embrouillamini d'émotions et de douleurs filmé avec une rare limpidité.
L'île rouge (2023) de Robin Campillo nous emmène à Madagascar peu après l'indépendance de l'île, en 1975, dans une base militaire française où un très jeune garçon découvre le monde des adultes. La vie est saisie, là encore, avec une justesse et une grâce parfaites.
Le plus grand moment du mois : Mes petites amoureuses de Jean Eustache, que je revois cinquante ans après. Dans cet autre film autobiographique, un garçon (plus âgé cette fois) découvre là aussi la vie et surtout les filles. C'est un mélange vibrant de Pialat (pour le naturel des situations) et de Bresson (pour le jeu désincarné des acteurs), avec une pincée de Tati dans certains plans. Un film froid et brûlant à la fois, qui nous offre les scènes de drague les plus prenantes qui soient, les fondus au noir les plus beaux, et où le charme agit lentement mais sûrement, certaines scènes touchant au sublime. Le film, à sa sortie, n'eut aucun succès.
 Eustache au travail. |
Et voici déjà juillet. Triste début d'été avec l'incendie qui fait rage dans les banlieues, allumé par une police de plus en plus violente et raciste et attisé par des émeutiers irresponsables et suicidaires. Ces jeunes crétins qui pillent et détruisent, qui vont jusqu'à brûler des écoles et des bibliothèques, impardonnable crime, travaillent sans le savoir pour la droite extrême au pouvoir en effarouchant le bon peuple. Et pendant ce temps, une certaine gauche refuse de condamner leurs violences, soumise qu'elle est à son chef irresponsable. A-t-il décidé, ce personnage toxique, de faire sombrer la gauche un peu plus encore ?
 Vous la voulez vot'baffe ? |
Quittons-nous plutôt en douceur. Écouté ces temps-ci des chanteuses d'autrefois : Lucienne Delyle, Suzy Solidor, vedettes avant- et après-guerre. À les écouter aujourd'hui, le public lambda croulerait de rire : elles sont l'apothéose de la désuétude. J'en riais moi aussi jadis, avant de tomber sous le charme de leurs voix travaillées, de leur diction parfaite qui change les mots en pierres luisantes et des paroles pas toujours inspirées en poèmes.
Lucienne Delyle, c'est l'équilibre classique. Voix plus sombre, Suzy Solidor, femme aimant les femmes et le proclamant dès les années 30 (bravo !), qu'on voit intégralement nue sur Internet (bravo !), dégage un léger parfum de soufre aussi bienvenu qu'inattendu.
 La Solidor |
Au programme d'août, Nadeau et Feydeau toujours, Boileau et Boileau-Narcejac, Jemison, Echenoz, Vigarello...
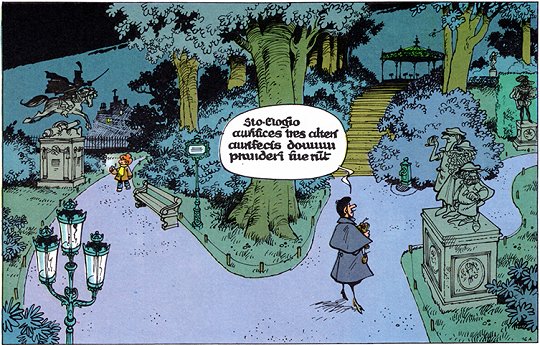 Will, Franquin, Macherot, Delporte, L'astragale de Cassiopée |
(réponse sur le numéro de la citation...)
Une phrase maladroite est souvent plus près de la vérité qu'une phrase simple et élégante. Il est possible aux marchands de canons d'avoir la conscience pure, mais je n'ai jamais rencontré de pacifiste dont le regard ne décèle un certain sentiment de culpabilité.
J'ai toute ma vie estimé les hommes plus par ce qu'ils ne faisaient pas en certaines occasions, que par tout ce qu'ils eussent pu faire.